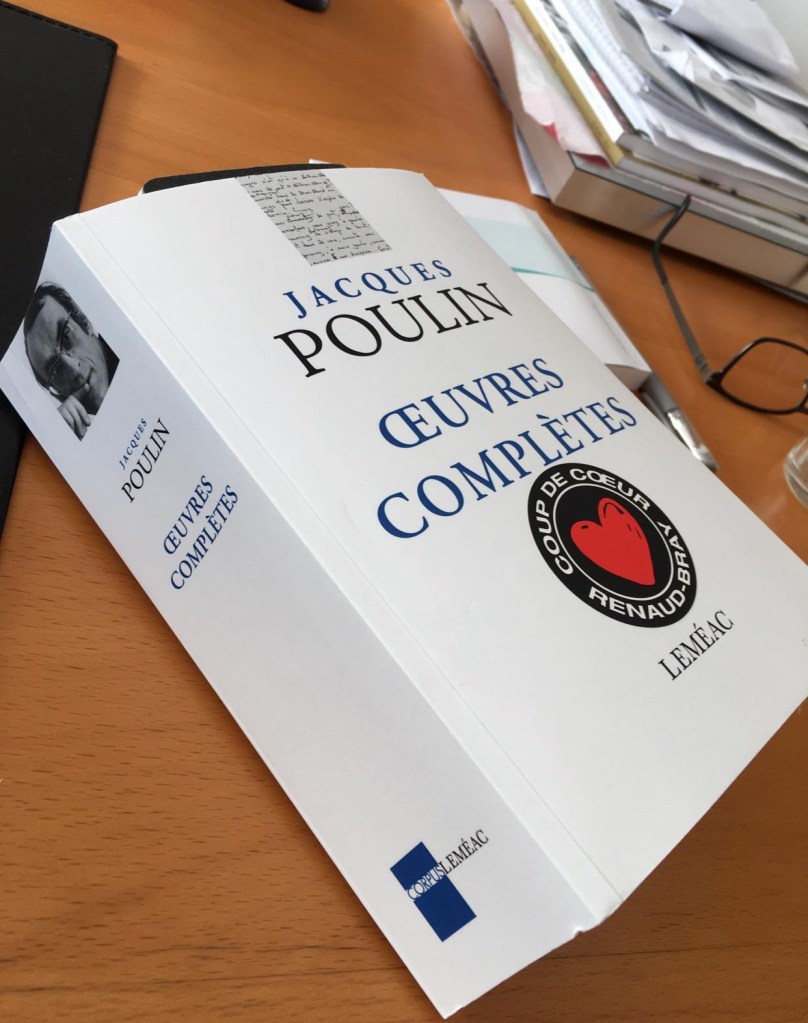Ça va mal. Les textes de ma troisième année d’écriture sont tout juste bons à être jetés à la poubelle. La première année, on le sait, a été publiée. La deuxième année est en cours de révision, d’abord par Bibi –je lui ai donné jusqu’à la fin de février– puis ce sera par moi, puis ce sera Ludo, puis ce sera Ludo et moi. Je me suis donc lancée ces derniers jours, d’ici le retour de mon manuscrit, dans une lecture sommaire des textes de la troisième année.
Il faut dire, à ma décharge, que j’étais sur le point d’être opérée pour le remplacement de ma valve mitrale. Il y a quelques textes intéressants, il est vrai, qui ont trait à mes visites préparatoires à l’hôpital. Puis, le 19 juin 2013, j’étais opérée. Le 19 juin, c’est tout juste un mois et demi après le début d’une année d’écriture, en ce sens que le 1er mai est la date qui me voit entamer une nouvelle année.
Dans le mois qui a suivi ma chirurgie, je dirais même jusqu’à la fin du mois de juillet, j’ai subi les effets de l’anesthésie. Je n’étais pas Lynda telle que je me connais, mais une Lynda comédienne sur scène qui s’exprimait avec emphase. Je m’en rendais compte, et j’espérais que la journée à venir allait me voir moins comédienne que celle de la veille, mais le changement fut très graduel. Je me disais intérieurement que j’allais essayer d’être moins extatique, mais, à la première occasion, je recommençais à m’exclamer et à m’exprimer à grand renfort de gestes. Cette exacerbation du moi transparaît, on s’en doute, dans mes écrits.
J’ai bénéficié d’un congé du travail d’une durée de trois mois. Je pense qu’à mon retour à l’université, mi-septembre, j’ai mesuré à quel point l’inventivité allait constituer un défi de taille : écrire un texte par jour sans jamais savoir à l’avance ce que j’allais écrire sollicitait une disponibilité mentale que je n’avais pas. Je n’étais pas encore assez forte. D’ailleurs, il a fallu que j’insère une journée de vacances, le mercredi, dans mes semaines de travail jusqu’à ce qu’on atteigne la fin de l’année.
Pour ne pas, pour autant, interrompre mon défi titanesque, j’ai décidé de consacrer plusieurs textes à la description des toiles qui couvraient, à l’époque, les murs de l’appartement de Montréal. Puis, après avoir décrit une vingtaine de toiles, j’ai décrit les vingt-six photos d’un autre projet, celui « au foulard rouge ». Cela veut dire que ces textes du troisième tome, pour être compréhensibles, devraient s’accompagner d’une photo desdites oeuvres. Voilà qui augmente énormément le prix de mon projet déjà déficitaire…
Je ne sais donc pas ce que je vais faire : imprimer une troisième année de laquelle auront été retirés tous les textes ratés ? Avec ou sans photos là où il en faudrait ? Sauter carrément une année ? Et si la quatrième année s’avère aussi mauvaise que la troisième, que vais-je faire ? Constater que je me leurre quand je considère que l’écriture est essentielle à ma vie ? Ou constater, plutôt, que je me leurre quand je pense que mon écriture peut être intéressante pour autrui ? Au secours !